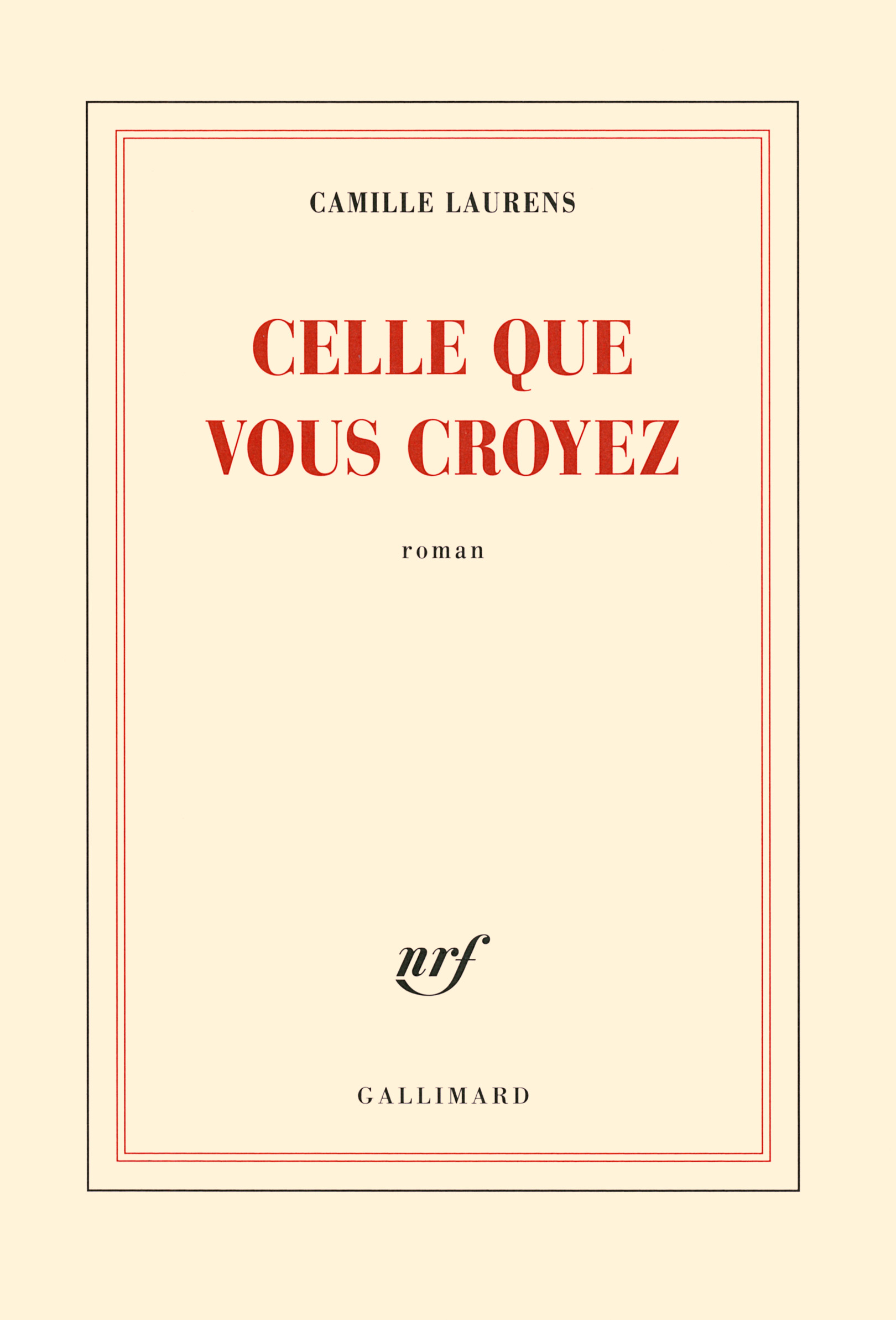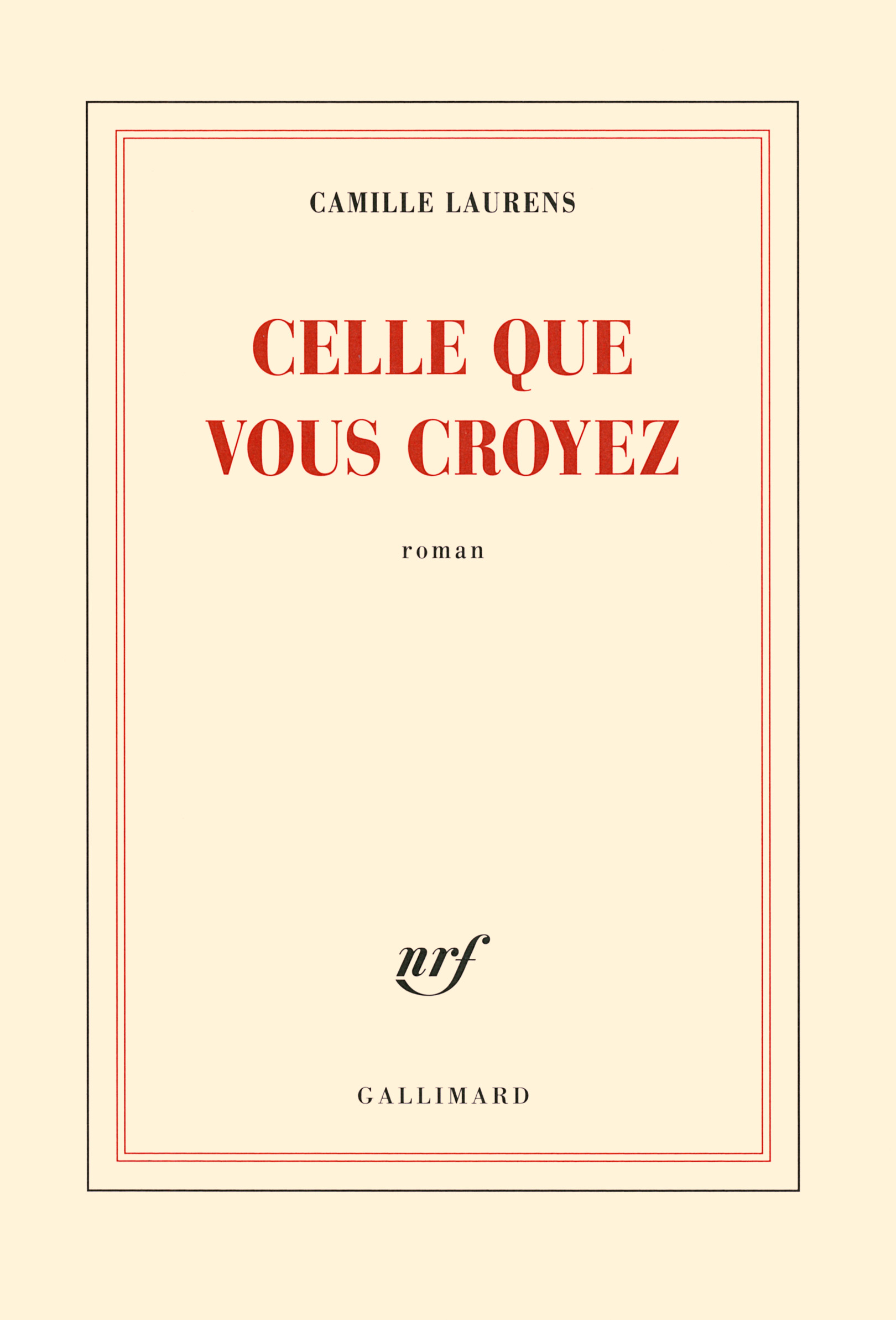
Divorcée, 48 ans, Claire vient de rompre avec son amant. Plus exactement, c’est ce dernier, aussi grossier que volage, qui la quitte. Éprise, malgré la manière dont Jo la traite, Claire se crée un profil sur Facebook et demande à devenir « ami » avec l’ami de Jo, photographe, pour maintenir le contact, quand bien même celui-ci est virtuel et à sens unique. C’est sous les traits d’une superbe jeune femme brune de 24 ans aimant la photographie que Claire prend donc contact avec Christophe ou plutôt, son pseudo, KissChris. D’envoi de « likes » en messages privés et SMS, KissChris tombe amoureux. Mais de qui exactement ? Et que faire lorsque ce dernier demande à rencontrer Claire ?
Au-delà de l’histoire de deux êtres en mal d’amour pris dans le piège de la Toile et des réseaux sociaux, au-delà de ce que ces échanges virtuels disent de ceux qui les alimentent, les lisent et les commentent, Camille Laurens narre l’histoire d’une femme qui refuse ce que la société lui renvoie, à savoir qu’une femme, passée l’âge de 45/50 ans, n’est plus désirable. L’écriture, en tension, cinglante, est prodigieusement efficace et emmène le lecteur dans une histoire à double fonds dont les rebondissements donnent le vertige. Parsemé d’extraits d’auteurs célèbres qui ont écrit sur l’amour et le désir, Celle que vous croyez, par ses interrogations sur le rôle de l’écriture, sur le rapport entre le désir et l’écriture et sur ce qu’il est permis d’écrire –la vérité toute nue ou quelque chose qui s’en approche – n’est pas sans rappeler le dernier livre de Delphine de Vigan, D’après une histoire vraie. Ce, d’autant que la dépression et la folie y ont aussi une grande place.
Celle que vous croyez est un cri d’espoir et de désespoir, un cri d’effroi, un cri d’amour, venu de la partie la plus archaïque qui sommeille en nous.
Extrait, page 141 : « On écrit pour garder la preuve, c’est tout. Les livres sont faits de ces souvenirs qui s’entassent comme les feuilles d’arbre deviennent la terre. Des pages d’humus. Je suppose que tu vas me trouver folle mais souvent j’ai fait l’amour pour pouvoir écrire, enfin je faisais l’amour pour faire l’amour, mais il n’y a jamais eu de grande différence pour moi entre le désir et le désir d’écrire – c’est le même élan vital, le même besoin d’éprouver la matérialité de la vie. Tu vas me dire que c’est le contraire, que l’un compense le manque de l’autre, qu’on s’exile de la vie dans sa représentation, qu’on écrit parce qu’on ne baise pas (…) ou bien qu’en écrivant on sublime nos instincts animaux, que le corps et la langue, ce n’est pas la même chose. Rien n’est moins sûr – d’ailleurs le mot « langue », rien que le mot « langue » est d’une obscénité folle. Moi, jamais, jamais, je n’ai pu le prononcer dans son sens linguistique sans penser à son autre sens, sans éprouver la présence dans ma bouche de la chose en même temps que du mot, sans voir quasi sous mes yeux les organes se mêler, s’effleurer, se chercher. J’ai besoin de l’épaisseur de la langue, quand j’écris, et de sa finesse, et de sa douceur, et de son âpreté. Ce serait intraduisible dans un autre idiome, ce que je te raconte. Je me vautre sauvagement dans la langue française, dans aucune autre. Je lèche, je suce, je goûte, j’aspire, je fais naître le désir sous ma langue, qui est aussi désir de savoir ». Camille Laurens.